|
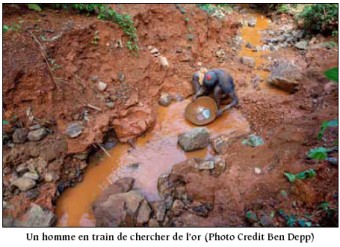
Haïti
est peut-être le « pays le plus pauvre des Amériques » mais
cette petite nation est également assise sur une mine d’or.
Le
nouveau Premier ministre Laurent Lamothe dit miser sur la
richesse qui se trouve dans les montagnes du nord d’Haïti pour
sortir le pays de la pauvreté, mais si le passé est garant de
l’avenir, l’exploitation de l’or, de l’argent et du cuivre
cachés dans les montagnes profitera principalement aux
actionnaires étrangers tout en défigurant un paysage déjà dénudé
et fragile.
Haïti a
peut-être quelque chose à gagner, mais elle a également beaucoup
à perdre.
Alors
qu’une poignée de cultivateurs gagnent cinq dollars par jour à
construire des chemins miniers, et pendant que les journalistes
parlent d’un ou deux sites de forage, une entreprise canadienne,
Eurasian Minerals, accapare discrètement et minutieusement les
permis d’exploration – 53 pour être précis – et conclut des
ententes secrètes, vraisemblablement avec l’aide d’un ancien
ministre de haut rang, aujourd’hui stipendié.
L’aubaine est si belle pour les compagnies minières et tellement
néfaste pour Haïti, que le directeur de l’agence nationale
responsable des mines les a récemment dénoncées lors d’une
entrevue exclusive avec Ayiti Kale Je (AKJ), appelant son
gouvernement à rectifier le tir : « Je leur ai dit de laisser
les minerais sous terre, les générations futures pourront les
exploiter. »
« Les
mines font partie du patrimoine national [...] Elles
appartiennent à la population, elles n’appartiennent pas aux
gens au pouvoir, même pas au propriétaire du terrain »,
ajoute
le géologue Dieuseul Anglade, alors
directeur du Bureau des mines et de l'énergie
(BME).
Eurasian
et son entreprise associée, Newmont Mining, deuxième producteur
aurifère mondial,
forent également illégalement,
de
connivence avec certains membres du gouvernement,
dans le secteur
de Lamielle, dans le nord-est du pays.
La loi
haïtienne diffère de celle de nombre d’autres pays. Elle est
nettement plus bureaucratique, mais elle prévoit également, au
prime abord, un minimum de protection. Pour pouvoir forer – même
à des fins d’exploration – les entreprises doivent obtenir une
convention d’exploitation minière signée par le Premier ministre
et l’ensemble des ministres. Cette convention établit les
modalités pour toute exploitation minière.
Eurasian
et Newmont attendent actuellement l’approbation finale d’une
convention couvrant un vaste territoire, soit environ 1 350
kilomètres carrés. Toutefois, la convention n’a pas encore été
signée, en partie parce que pendant le plus clair des 12
derniers mois, Haïti n’avait pas de Premier ministre. « Nous
sommes prêts à forer », déclarait Daven Mashburn de Newmont
Mining, vers la fin de 2011, en parlant de Lamielle.
« Puisque le gouvernement d’Haïti s’en fout […] il nous est
impossible de mettre en œuvre nos concessions et cela signifie
que les gens ne peuvent trouver d’emplois. »
Pourtant, le gouvernement est loin de s’en foutre. Peu après
cette entrevue, les concessions ont été consenties, quoique
d’une manière pas tout à fait légale. « Le
gouvernement leur a accordé une sorte de dérogation »
a expliqué Ronald Baudin (ministre des Finances d’Haïti de 2009
à 2011 et ancien directeur général du
ministère), qui a supervisé les négociations avec
Eurasian alors qu’il occupait cette puissante position. « Ils
sont conscients du tort qu’ils font à la compagnie… Celle-ci a
plusieurs bases, plusieurs camps partout dans le pays, avec une
très importante logistique. Elle dépense beaucoup d’argent. Et
voilà qu’elle arrive à une étape et reste bloquée, du seul fait
que la convention n’a pas encore été signée. »
Baudin,
qui a quitté ses fonctions lorsque le nouveau gouvernement de
Michel Martelly a été mis en place en 2011, est aujourd’hui un
conseiller rétribué du partenariat Eurasian-Newmont qui porte le
nom de « Newmont Ventures ».
Toutefois, un protocole d’entente ne saurait l’emporter sur une
loi. Aucune dérogation n’est possible en matière de législation.« Il
y a ce qu’on appelle la hiérarchie des lois. D’après cette
hiérarchie, un protocole est plus faible qu’une loi. Un
protocole ne peut pas annuler une loi. Il ne peut pas autoriser
à faire quelque chose que la loi n’autorise pas »,
a expliqué l’avocat des droits humains, Patrice Florvilus.
Le
directeur de l’agence responsable des
mines – le BME – n’a pas signé le protocole d’entente. « Je
n’étais pas d’accord, pour la simple et bonne raison que si la
loi n’autorise pas quelque chose, … vous n’avez pas le droit de
le faire! » d’expliquer Anglade au cours d’une entrevue le
24 mai 2012. Son bureau n’en a même pas reçu un exemplaire.
Ce refus a été sans doute l’une des raisons pour que l’un des
premiers actes officiels du nouveau gouvernement Lamothe aura
été de destituer Anglade. Anglade, âgé de 62 ans, compte près de
30 années de service au BME, qu’il a dirigé au cours de près des
20 dernières années. Il a une réputation d’honnêteté.
Malgré le refus d’Anglade, le protocole d’entente a été signé
par l’actuel ministre des Finances et celui des Travaux publics
vers la fin du mois de mars. Ainsi, le 23 avril, Eurasian a pu
joyeusement rapporter à ses actionnaires que
« le partenariat a obtenu la permission de forer pour certains
projets grâce au protocole d’entente; et le forage se poursuit
présentement ».
Eurasian et Newmont n’ignorent point la législation et, selon
une correspondance avec AKJ en date du 25 mai, semblent croire
qu’Anglade a signé le document. Mais tel n’est pas le cas.
Anglade
est également en désaccord avec une convention d’exploitation
minière qui risque d’être signée sous peu, vu qu’après trois
mois d’attente, Haïti a enfin un Premier ministre, Laurent
Lamothe, qui s’est engagé à rendre la législation du pays plus
favorable aux affaires.
Selon
Anglade, la version finale – qu’il a rejetée par l’entremise
d’une lettre officielle au président de l’époque, René Préval et
au ministre des Finances à ce moment-là, Baudin – est beaucoup
plus faible que les deux plus petites conventions minières
existantes d’Haïti (pour 50 kilomètres carrés chacune) parce que
les principales clauses de sauvegarde ont été supprimées.
L’article 26.5 – des conventions antérieures – plafonnait les
dépenses qu’une entreprise pouvait déclarer à 60 pour cent des
revenus. Il est à présent caduc, selon le directeur du BME.
« Ce
qui veut dire que la compagnie peut venir dire qu’elle a dépensé
90 dollars, qu’il ne reste plus que 10 dollars »,
dit Anglade.
Une
deuxième clause a également été supprimée, dit-il : l’Article
26.4, qui garantissait un partage à parts égales des profits
entre les entreprises minières et le gouvernement. « Durant
les 2 années passées à négocier; ma position était claire
[...] »,
de dire cet homme de 62 ans, qui a passé toute sa vie dans la
fonction publique et enseigne aussi les mathématiques à
l’Université d’État d’Haïti. « Ces
2 articles le Bureau des mines n’a jamais voulu les enlever
[...] C’est lorsque le dossier a quitté le Bureau des mines,
qu’ils ont négocié et enlevé ces articles. Ce n’est point moi
qui les ai enlevés. Après le Bureau des mines [...] ils ont fait
une réunion au ministère des Finances [...] C’est le ministre
lui-même qui les a ôtés, le ministre Baudin. »
Interrogé à propos de la convention, Baudin a dit qu’il ne
pouvait entrer dans les détails. Il a néanmoins déclaré que :
« Ce
que moi personnellement je puis vous dire, à présent nous avons
un texte qui a obtenu le consensus de la compagnie, du ministère
des Travaux publics, du Bureau des mines, du ministère des
Finances. »
Pas
d’après Anglade. « Pour
rien au monde je n’enlèverais ces articles »,
dit-il.
Le
ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau est le supérieur
d’Anglade. Son ministère supervise le BME et est en possession
de la convention pendante. Rousseau a refusé cinq
demandes d’entrevue; c’est pourquoi l’absence des clauses de
sauvegarde dans le document ne peut être confirmée. Cela dit,
Anglade jure que les mesures sont absentes, et entre-temps, le
protocole d’entente illégal a été rendu public, et Baudin est
ostensiblement à la solde de Newmont. « Je veux que ce soit
clair pour la nation »
a expliqué Anglade,
« le BME
n’est pas responsable de ce qui a été fait au profit de
l’entreprise jusqu’à maintenant ».
Lorsque
Baudin a été interrogé à propos du conflit d’intérêts potentiel
découlant du fait qu’il ait occupé les fonctions de ministre des
Finances avant de se recycler immédiatement en consultant à la
solde de Newmont, il est resté de marbre. « Il
existe d’autres pays où, lorsque quelqu’un a fini d’exercer de
telles responsabilités, il y a une période de temps au cours de
laquelle il n’a pas le droit de travailler pour le privé. Mais
en la circonstance, il a une compensation. Nous autres, nous
n’avons pas cela dans notre législation, »
d’accoucher Baudin. « Et
aujourd’hui, au moment où je vous parle, depuis mon départ du
ministère des Finances, je ne reçois pas une gourde de l’État.
Ensuite, je dois manger, n’est-ce pas? Je dois m’habiller
[...] »
Que
recèlent les collines d’Haïti?
Pourquoi
Newmont, Eurasian et d’autres entreprises minières ont-elles
attendu des années pour obtenir la signature d’une convention,
pour ensuite violer la loi haïtienne avec le protocole
d’entente?
Si les
calculs des géologues disent vrai, les montagnes au nord d’Haïti
contiennent des centaines de millions d’onces d’or. Puisqu’une
once d’or est actuellement négociée à 1 600 dollars us, une
estimation chiffre la cagnotte à 20 milliards.
La mine
de Pueblo Viejo, directement de l’autre côté de la frontière, en
République dominicaine, dans la même « ceinture de
minéralisation » qui s’étend d’un bout à l’autre de l’île,
renferme la plus grande réserve aurifère des Amériques. Elle a
déjà permis de produire 5,5 millions d’onces d’or et en contient
au moins 23,7 millions de plus. Elle est également riche en
argent : 25,2 millions d’onces déjà et 141,8 millions à
extraire.
Vu les
réserves apparemment vastes d’Haïti (et son faible
gouvernement), il n’est pas étonnant que le géant minier Newmont
se soit associé avec Eurasian, dirigée par un ancien cadre de
Newmont. Eurasian, par l’entremise de son associée locale,
l’entreprise Marien Mining, contrôle différents types de
concessions représentant une plus grande partie du territoire
d’Haïti que toute autre entreprise : l’équivalent d’un dixième
du pays.
Une
petite entreprise minière haïtiano-étatsunienne,
VCS, et son entreprise associée
locale, Delta Mining, possèdent ou contrôlaient jusqu’à tout
récemment des concessions couvrant 300 kilomètres carrés dans le
nord; l’entreprise canadienne Majescor et ses partenaires
haïtiens possèdent des licences pour 450 kilomètres carrés de
plus. Ensemble, les entreprises étrangères possèdent des permis
de recherche ou d’exploration pour un tiers du nord d’Haïti,
15 pour cent du territoire du pays.
Majescor
a plusieurs longueurs d’avance sur ses rivales, ayant récemment
entamé la phase d’ « exploitation » pour l’une de ses
concessions. Cependant, VCS et Newmont-Eurasian la talonnent.
Toutes ces entreprises reconnaissent le potentiel d’Haïti.
« Haïti
est le géant endormi des Caraïbes! » a dit un partenaire de
Majescor récemment, alors que le président d’Eurasian, David
Cole s’est vanté lors d’une émission de radio de : « […]
contrôler plus de 1 100 milles carrés de terres ».
Un
investisseur qui se qualifie de « géologue mercenaire » a écrit :
« il est évident qu’il existe un risque géopolitique
important en
Haïti.
Mais la géologie est simplement trop bonne. »
La géologie est en effet très bonne. Un seul petit site d’Eurasian,
le gisement de Grand-Bois, pourrait contenir au moins 339 000
onces d’or (d’une valeur de 5 milliards 400 millions de dollars
us au prix d’aujourd’hui) et 2 milliards 300 millions d’onces
d’argent.
Bonne en
effet, mais il y a un prix élevé à payer.
Mines à ciel ouvert à l’horizon
Parce
que dans la majorité des endroits les gisements de cuivre,
d'argent et d'or sont pour la plupart répartis comme de
minuscules grains dans la boue et les pierres – ce qui est
parfois appelé « or invisible » – cette onéreuse exploitation
minière à ciel ouvert est souvent la seule option, mais
l’entreprise associée d’Eurasian, Newmont, connaît bien ce mode
d’exploitation. Le géant minier a ouvert la première mine à ciel
ouvert au Nevada en 1962 et a ensuite creusé au Ghana, en
Nouvelle–Zélande, en Indonésie, et dans d’autres pays.
Au
Pérou, Newmont exploite l’une des plus grandes mines aurifères à
ciel ouvert du monde : la mine de 251 kilomètres carrés de
Yanacocha. Il y a peu de temps, Newmont a été accusée de trafic
d’influence lorsque la lumière a été faite sur ses liens avec
l’ancien maître espion péruvien Vladimiro Montesinos. Après
avoir présumément aidé Newmont à négocier des termes favorables,
un ancien employé du Département d’État des États-Unis est
devenu salarié de Newmont. L’entreprise a également été accusée
d’avoir déversé du mercure et du cyanure.
Imperturbable, Newmont a récemment entrepris la mise en chantier
d’une mine d’envergure, la « Minas Conga ». Cependant, les
cultivateurs, les écologistes et les autorités locales ont
jusqu’à maintenant contrecarré ses plans à l’aide de
manifestations massives et devant les tribunaux. Le mois dernier,
une table ronde d’experts européens mandatée par le gouvernement
pour étudier les plans, a indiqué à Newmont qu’elle ne serait
pas autorisée à drainer deux lacs des hautes Andes pour la
nouvelle mine.
Le 28
mai, Newmont n’avait pas encore décidé de la voie à suivre, mais
une dépêche du 27 avril de l’Associated Press citait Richard
O’Brien de Newmont disant que « si ce projet de 4,8 milliards
de dollars ne peut être mis en oeuvre “de façon responsable au
point de vue sécuritaire, social et environnemental” tout en
rapportant aussi des “dividendes acceptables” aux actionnaires,
Newmont réallouera ce capital à d’autres projets de
développement de notre portfolio ».
Newmont
a également eu des problèmes dans d’autres pays, plus récemment
au Ghana. La mine « Ahafo South » est
située
dans une région agricole connue comme le « grenier à vivres » du
Ghana. À cette date, elle a déplacé environ 9 500 personnes,
dont 95 pour cent vivaient de l’agriculture, selon Environmental
News Service.
Outre
d’expulser des cultivateurs de la terre, Newmont a contaminé
l’approvisionnement local d’eau au moins une fois, de son propre
aveu. En 2010, cette compagnie acceptait de payer 5 millions de
dollars us de compensation au gouvernement pour un déversement
de cyanure en 2009 qui a tué du poisson et pollué l’eau potable.
Newmont concédait que les procédures en vigueur n’avaient pas
été suivies, et que son personnel avait aussi omis d’aviser
comme il se doit les autorités gouvernementales ghanéennes.
Tout en
accueillant les bénéfices éventuels que des mines bien
construites et bien supervisées pourraient apporter à Haïti,
Anglade et d’autres experts haïtiens se montrent préoccupés à
l’effet qu’une mine à ciel ouvert, qui à toutes fins utiles
utilise d’importantes quantités de cyanure pour séparer le
minerai d’or de la gangue, pourrait s’avérer dangereuse pour
l’environnement déjà fragile d’Haïti.
Dans la
République dominicaine voisine, une mine d’or contrôlée par le
gouvernement a causé tellement de contamination que les
rivières de la région coulent encore avec une eau rougeâtre à
mesure que la pluie rejette des métaux du minerai laissé aux
alentours. « L’exploitation minière peut causer de graves
problèmes environnementaux » a fait remarquer l’ancien
ministre haïtien de l’Environnement à l’occasion d’une récente
entrevue.
À ce
poste au milieu des années quatre-vingt-dix, Yves-André
Wainwright signait les deux conventions minières existantes. Cet
agronome de formation indiquait que, outre les soucis qu’il se
fait concernant les métaux lourds, certaines des surfaces de
concession sont formées de « montagnes humides », ce qui
signifie qu’elles jouent « un rôle important pour la
biodiversité et doivent être protégées, dès la phase de
prospection ». C’est là aussi que vivent des dizaines de
milliers de familles de cultivateurs. Cependant on n’a jamais vu
l’ombre d’un membre du personnel du ministère de l’Environnement
sur les sites miniers, d’après des journalistes des les radios
communautaires dans les zones affectées.
En fin
de compte, ce qui inquiète Wainwright, aussi bien qu’Anglade et
d’autres observateurs, c’est l’incapacité de « l’État faible »
haïtien d’exercer un contrôle sur les compagnies minières et les
dégâts environnementaux potentiels.« Nous avons un personnel
compétent au Bureau des mines, mais ils n’ont pas les moyens de
mener à bien leurs tâches, » de dire Wainwright. « Tout
l’argent qui provient des carrières de sable, et d’autres mines,
aboutit directement au ministère des Finances. De ce fait, même
si c’est un secteur qui fait entrer de l’argent, le BME est dans
la dèche. »
Le
jugement de Wainwright semble se vérifier. Un audit des
véhicules du BME dévoilé au mois de janvier montrait que des 17
véhicules, seulement cinq étaient en condition de rouler. Douze
étaient hors d’usage. Et avec un budget d’environ 1 million de
dollars, le BME est aussi à court de personnel. Seulement le
quart des 100 employés détient un diplôme universitaire. Un
autre 13 pour cent est formé de « techniciens ». Le reste est
constitué par le secrétariat et le personnel de « soutien ».
« Le
gouvernement ne nous donne pas les moyens nécessaires pour être
à même de superviser les compagnies »,
confirmait Anglade à l’occasion d’une
entrevue accordée alors qu’il était toujours à la tête du BME.
« Le gros de notre budget va pour les salaires.
Nous n’avons pas réellement un budget d’opération. »
La
branche d’investissement pour le secteur privé de la
Banque mondiale – la Société
financière internationale (International Finance Corporation) –
a investi 5 millions de dollars dans Eurasian pour l’exploration
en Haïti. La Banque affirme qu’Eurasian et Newmont ont de bons
antécédents, mais est également consciente des éventuels effets
négatifs potentiels de l’exploitation minière et reconnaît les
défis auxquels font face le gouvernement haïtien et
d’autres « États faibles ».
« Souvent le gouvernement du pays hôte n’a pas beaucoup de
possibilités, spécialement en ce qui a trait aux aspects
environnementaux et sociaux, »
expliquait Tom Butler, responsable à l’échelle internationale
des investissements miniers de la Société financière
internationale. « (Mais) une des choses qu’on ne fait pas,
c’est dire au gouvernement quoi faire avec l’argent qu’il reçoit. »
Haïti
bon dernier dans la « course aux royalties »
Combien
d’argent rentrera, et quand? Des articles récents ont cité
toutes sortes de chiffres prometteurs, mais ils omettent les
petits caractères dans les conventions existantes, et ne
mentionnent même pas la convention en instance.
Aussi,
quelle que soit la qualité de la convention, à part les mises de
fonds initiales, une mine ne commencerait probablement pas à
rapporter de revenus – taxes et royalties – avant cinq ou même
dix ans, car c’est le temps nécessaire pour construire une mine
à ciel ouvert, et étant donné qu’il est permis aux compagnies de
d’abord amortir leur équipement, remettant à plus tard le
« passage du rouge au noir ».
Daven
Mashburn de Newmont le confirmait en disant que « cela
pourrait aisément prendre une décennie. Cela prend
habituellement une décennie pour mettre ces choses en marche ».
« Il est fort probable qu’une grande entreprise minière déclare
des pertes année après année, même après dix ans, si le système
de déductions est trop généreux et que les contrôles font
défaut, »
indiquait récemment l’experte en fiscalité minière et royalties,
Claire Kumar dans une entrevue avec AKJ. « C’est quelque
chose de très courant. »
Chercheuse à l’organisme Christian Aid et auteure du rapport de
38 pages paru en 2009, Undermining the Poor – Mineral
Taxation Reforms in Latin America (« Miner » les pauvres –
Réformes de la taxation minière en Amérique latine), Kumar
disait que les deux petites conventions existantes d’Haïti
paraissent bien, étant donné qu’elles promettent un partage
équitable des profits et prévoient un plafond pour les dépenses.
Ce qui
n’est pas si bon, faisait-elle remarquer, c’est le taux des
royalties d’Haïti : 2,5
pour cent. Selon Kumar et de récentes dépêches d’agences, ce
taux est l’un des plus bas de l’hémisphère.
« Une
redevance de 2,5 pour cent est beaucoup trop basse »,
de confirmer Kumar. « Toute redevance de moins de 5 pour cent
est tout simplement ridicule pour un pays comme Haïti. On ne
devrait même pas en tenir compte. Pour un pays avec un État
faible, les royalties sont le moyen le plus sûr de toucher les
sommes attendues. Il existe une marge de manipulation pour
l’entreprise, mais elle n’est pas aussi vaste que vous pourriez
le penser. »
Le taux
des royalties d’Haïti a encore du chemin à faire pour rattraper
ce que les investisseurs miniers déplorent comme une « course
aux royalties » et un « nationalisme des ressources ». Dans son
rapport annuel Business Risks Facing Mining and Metals
présenté en août dernier, la firme comptable et d’investissement
Ernst & Young place le « nationalisme des ressources » en « tête
de liste des risques pour les affaires ». Cette agence
disait qu’à la fin de l’année 2010 et en 2011, on pouvait
compter 25 pays qui avaient augmenté les taux ou menaçaient de
le faire.
Beaucoup
de ceux qui ont élevé les taux pour l’or se trouvent en Amérique
latine. L’Équateur exige à présent entre 5 et 8 pour cent, le
Pérou en est à 12 pour cent, et le Brésil menace également
d’augmenter son taux. En août dernier, le Venezuela est allé
plus loin et a nationalisé l’industrie aurifère.
Dans un
texte sur le « nationalisme des ressources » du mois de
mars, Reuters concluait que (cela) « a laissé aux sociétés
minières peu d’options autre que de
se lancer vers d’autres territoires encore plus à risque
politiquement, y compris des régions agitées de l’Afrique ».
Ou… Haïti.
Car, avec un taux de royalties de 2, 5 pour
cent, une force de casques bleus de l’ONU forte de 10 000
soldats cantonnés à travers le pays, et des indications que les
nouvelles conventions minières seront plus avantageuses pour les
sociétés étrangères, les risques
aujourd’hui sont vraisemblablement moindres qu’au cours des
récentes décennies.
De fait,
Dan Hachey, Pdg de Majescor, applaudissait l’élection
en 2011 du président Martelly, disant : « Martelly a déclaré
que (Haïti) est ouverte pour les affaires. Nous avons vu
beaucoup de changement depuis son accession à la présidence. »
Le
système de la porte tournante qui a permis à l’ancien ministre
des Finances Ronald Baudin de s’engager dans l’équipe Newmont
pourrait être l’une des raisons de ce changement. Alors qu’il
était encore au pouvoir, il acceptait de transiger un bail
gratuit de 50 ans pour un terrain avec une société française
dans le nord. « Non, nous ne l’avons même pas loué. Nous
l’avons mis à sa disposition, car lorsque c’est quelque chose
qui est bon pour l’économie qui se fait, l’État a pour devoir de
l’encourager. »
Le
nouveau Premier ministre haïtien – Laurent Lamothe – est aussi
très favorable au milieu des affaires. Entrepreneur en
télécommunications et dans l’immobilier avec des sociétés en
Afrique et en Amérique latine, il s’est engagé à faire avancer
une législation favorable aux affaires dans tous les secteurs, y
compris les mines.
« L’information au sujet de nos réserves nationales indique que
notre terre regorge de minéraux et que c’est maintenant le
moment propice pour les exploiter »,
déclarait Lamothe dans sa déclaration de politique générale
devant le Sénat le 8 mai dernier.
Lamothe
a aussi promis de modifier la législation minière. Au cours
d’une récente interview avec l’Associated Press, Lamothe s’est
engagé à ce que la nouvelle loi assure que « l’État reçoive
sa juste part » et qu’elle protège également l’environnement
et les communautés locales. Mais, il bifurquait, ajoutant que la
nouvelle législation permettrait ceci « autant que possible
sans nuire
aussi aux
revenus de l’autre partie, pour lui permettre de faire des
affaires ».
Même avant
que Lamothe ait pris ses fonctions, Anglade confiait à AKJ être
au courant des pressions faites pour une modification de la loi
existante.« Je dois vous dire que les entreprises font toutes
sortes de pressions pour faire modifier la législation afin que
cela leur donne plus d'avantages. Mais ils ont trop d'avantages
déjà! » a-t-il dit.
Un
gouvernement dont la devise est « Haïti est ouverte aux
affaires » et qui parie sur des manufactures d’assemblage et un
salaire minimum de 5 dollars US par jour (le plus bas de
l’hémisphère), peut-il être digne de confiance quant à la
protection des intérêts du pays?
Les
géants de l’industrie minière ont eu constamment le dessus face
à des États beaucoup plus forts et obtenu des contrats
profitables principalement à leurs actionnaires. Quelle garantie
ont donc les Haïtiens que le pro business Lamothe
obtiendra un meilleur traitement que les gouvernements du Pérou,
du Ghana, ou d’autres pays pauvres?
Les
éventuels revenus miniers et les quelques emplois à bas salaire
semblent de bon augure pour plusieurs en Haïti, où la plupart
des gens doivent survivre avec moins de 2 dollars US par jour et
où le chômage et le sous-emploi atteignent 66 pour cent.
Mais
l’industrie minière est-elle la réponse aux malheurs d’Haïti?
Pour
Laurent Bonsant, un entrepreneur minier canadien travaillant
pour Newmont Ventures dans le nord, la réponse est « Oui ».
« L’une des choses qu’il faut à ce pays, c’est un produit
d’exportation. Ils n’ont rien. Si l’industrie minière peut faire
quelque chose de bon, c’est ici qu’elle le fera, »
disait-il tout en supervisant un site où une équipe forait 24
heures par jour des échantillons de minerai à 330 mètres sous
terre.
Mais
Haïti a plusieurs produits d’exportation et, de plus,
l’industrie minière n’a pas fait grand bien par le passé.
Au cours
des récentes décennies, des sociétés étrangères ont extrait de
la bauxite et du cuivre. Des dizaines de milliers de familles
ont perdu leurs terres, des milliers d’hectares ont été soumis à
la déforestation, et dans certains cas, la terre a été
contaminée.
Le
professeur Alex Dupuy, professeur
titulaire des Études africaines américaines et de sociologie de
la Wesleyan University, doute fortement que les résultats des
nouvelles entreprises s’avèrent bien différents des précédents.
Même si Haïti n’est plus régie par une dictature aussi
brutale et corrompue que celle des Duvalier, il existe peu de
transparence, et aucun moyen apparent de vérification ou de
contrôle des investisseurs locaux et étrangers.
« Je
pense qu’il va se produire la même chose, »
disait Dupuy, auteur de Haiti in the World Economy – Class,
Race and Underdevelopment, au cours d’une interview au
téléphone avec AKJ. « L’industrie minière n’utilise pas
beaucoup de main-d’oeuvre, et les nationaux qui seront engagés
seront des travailleurs non spécialisés. Les cadres viendront de
l’étranger car habituellement ces compagnies arrivent avec leur
propre technologie. »
« Comme
par le passé, elles exproprieront les terres des paysans. De
sorte qu’il en sera de même, tout comme précédemment. Les
contrats en passe d’être signés le seront au gré de la compagnie
étrangère, pas nécessairement ce qui est dans les meilleurs
intérêts du pays, même s’ils les présentent au public comme
quelque chose de bon pour le pays. »
[Voir
La sombre histoire d’une Haïti « ouverte aux affaires »]
Le
Guatemala – un pays socialement, économiquement et politiquement
similaire – pensait que les mines pouvaient « faire du bien »
là, aussi, et autorisait Goldcorp à ouvrir la Marlin Mine. Mais
en 2010, la
Commission interaméricaine des droits humains enjoignait au
gouvernement de la fermer temporairement à cause des risques
pour la santé, l’environnement et les droits humains. Un rapport
présenté en 2011 par des experts miniers associés à la Tufts
University recommandait au Guatemala de changer de façon
significative les règles du jeu: d’exiger des royalties plus
élevées et d’autres revenus, d’assurer une meilleure protection
environnementale et le nettoyage, et de garantir qu’une somme
donnée parvienne aux communautés hôtes.
« Sans une bonne gouvernance et des investissements productifs,
l’héritage pour les lieux de la Marlin Mine pourrait bien être
une dévastation écologique et l’appauvrissement, »
écrivaient les auteurs.
Anglade s’inquiétait à l’effet que quelque chose de semblable
pourrait arriver en Haïti, où le contrôle gouvernemental est
virtuellement inexistant. Par exemple, bien qu’il soit illégal
de couper des arbres, du bois fraîchement scié est empilé pour
être vendu dans les marchés partout à travers le pays. De nos
jours la couverture forestière d’Haïti n’est que de 1,5 pour
cent.
Plus au nord, nombre de cultivateurs qui auraient pu tirer
profit en louant leurs terres aux sociétés minières les ont
depuis longtemps vendues à des requins opportunistes accapareurs
de terres et aux hommes d’affaires associés à de précédentes
entreprises minières à Grand-Bois, un site d’Eurasian. Plus
d’une dizaine de familles cultivent à présent un terrain qui ne
leur appartient plus.
Anglade s’en souvient bien : « Quand
j’ai appris ce qui se passait, je me suis rendu sur les lieux
personnellement, j’ai dépensé mon propre argent parce que le
Bureau n’en avait pas; j’y suis allé pour réunir les gens et
leur dire que leurs terres ont des ressources minières, et de ne
pas les vendre. Malgré tout, ils les ont vendues. »
À
présent, les familles pauvres qui cultivent encore ces terres à
titre de locataires, et des centaines de leurs voisins,
s’inquiètent quant à la pollution et de se voir expulsés de
leurs lotissements. L’année dernière, plus de 200 familles ont
été chassées d’un plaine fertile située non loin quand le
gouvernement Martelly a inauguré une nouvelle zone franche.
Dans une région, Newmont a initié des « œuvres sociales », selon
Anglade. L’entreprise a fait bâtir un petit pont, une route pour
son petit véhicule tout-terrain et payé des frais de scolarité.
Les cultivateurs sont cependant toujours nerveux.« D’après
ce qui est prévu, on nous dit que la compagnie utilisera l’eau
de la rivière pour vingt années. De plus, personne ne pourra
boire l’eau qui coule de notre côté »,
d’expliquer la cultivatrice et organisatrice paysanne Elsie
Florestan, qui vit près du site de Grand-Bois. « De
plus avec ce qui va être fait, il y a des gens qui ne pourront
pas rester dans la zone. »
« Le
petit
groupe
qui s’enorgueillit de travailler, ce n’est pas la population, à
bien regarder il n’y a tout au plus que 50 personnes qui ont
trouvé du travail pour une population qui compte 64 habitations
[...] »
d’ajouter cette personne de 41 ans, membre du mouvement paysan
Tèt Kole Ti Peyizan. « D’après
ce que je constate, si le peuple ne s’organise pas pour frapper
du pied, pour dire qu’il lui faut obtenir quelque chose, il
n’aura rien »,
prévenait-elle.
Florestan et d’autres cultivateurs ont constamment pu observer
des équipes venir prélever des dizaines de milliers
d’échantillons de chaque colline et vallon pendant des années, à
travers tout le nord.« Sans
poser de questions, à savoir à qui appartient le terrain, ils
entrent, procèdent à des fouilles, prennent les pierres, les
mettent dans leurs sacs, et s’en vont avec »,
faisait remarquer l’organisateur paysan Arnolt Jean, qui habite
à Lakwèv, près de la frontière dominicaine. « Tous les
Haïtiens observent, car ils savent que ce qui pourrait nous
aider, c’est si nous avions un gouvernement qui serait à même de
nous dire : ‘Cette zone est à vous, il vous faut donc ouvrir les
yeux’. Mais nous en tant qu’ Haïtiens nous ne pouvons rien dire
[...] L’État est irresponsable dans ce dossier. »
Dans
cette communauté, les gens orpaillent et creusent leurs propres
tunnels depuis des générations. Une journée ou une semaine de
travail peuvent ne rien rapporter ou rapporter 50 dollars d’or,
même si les acheteurs de la République dominicaine ne paient que
la moitié du cours du marché. En outre, avec la plupart des
familles trop pauvres pour même se permettre d’envoyer tous
leurs enfants à l’école, ils sont nombreux les gens qui vont du
côté des collines et des berges dès qu’ils ont fini de planter
leurs semences. Le paysage est parsemé de trous. La rivière est
couleur de boue. « Le pays est pauvre, mais ce qui est dans
le sous-sol pourrait nous sortir de la pauvreté à tout jamais »,
de dire Arnolt. « Mais puisque notre
richesse reste sous terre, c’est les gens les plus riches qui
viennent chercher des moyens de les exploiter. Ceux qui habitent
la terre restent pauvres, et les riches s’enrichissent
davantage. »
Cet article est réalisé en partenariat avec Haïti Liberté
et rendu
possible en partie grâce à une bourse de
Pulitzer
Center on Crisis Reporting.
Ayiti Kale Je
–
http://www.ayitikaleje.org –
est un partenariat établi entre AlterPresse, la Société pour
l’Animation de la Communication Sociale (SAKS), le Réseau des
Femmes Animatrices des Radios Communautaires Haïtiennes (REFRAKA)
et les radios communautaires de l’Association des Médias
Communautaires Haïtiens (AMEKA) et les étudiants du Laboratoire
de Journalisme de la Faculté des Sciences Humaines de
l'Université d'Etat d’Haïti. |